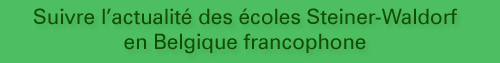- Détails
- Catégorie : Steiner - Conférences & extraits de livres
- Mis à jour : samedi 11 avril 2020 13:47
- Affichages : 1649
Rudolf Steiner – Autobiographie volume 1 – Chapitre X
© 1979 Éditions Anthroposophiques Romandes
(Tous droits réservés pour la version française – Reproduction complète ou partielle soumise à autorisation)
Lorsque je revois les trois premières décennies de mon existence, j'ai l'impression de les avoir menées jusqu'à un certain aboutissement. A la fin de cette époque je partis pour Weimar où, pendant près de sept ans, j'allais travailler aux Archives de Goethe et Schiller. Le temps passé à Vienne, depuis mon premier voyage à Weimar jusqu'à mon installation dans la ville de Goethe, peut être considéré comme une période où j'ai, dans une certaine mesure, pu trouver une conclusion aux aspirations profondes de mon âme. Cette maturation allait conduire à l'élaboration de ma « Philosophie de la Liberté ».
Un aspect essentiel de ma conception d'alors concernait le monde sensible qui, pour moi, ne constituait pas la véritable réalité. Dans mes écrits et articles de cette époque, je n'ai jamais manqué de souligner que la vraie réalité appartient à l'âme, grâce à l'action de la pensée qu'elle ne puise pas dans le monde physique, mais qu'elle exerce sous forme d'une activité affranchie de toute perception sensible. Je considérais que grâce à cette pensée « libérée des sens » l'âme pouvait participer à l'essence spirituelle du monde.
Mais j'insistais également, et avec force, sur le fait que l'homme, vivant dans cette pensée libérée des sens, a pleinement conscience de puiser à l'essence spirituelle fondamentale de toute existence. Pour moi, tous les discours relatifs aux limites de la connaissance n'avaient aucun sens. II me semblait que la connaissance consistait à retrouver les contenus spirituels préalablement vécus par l'âme dans le monde de la perception. Parler des limites de la connaissance c'était, selon moi, avouer que l'on n'avait pu expérimenter en esprit la véritable réalité, d'où il devenait impossible de retrouver cette dernière dans le monde perceptible.
En exprimant mes propres convictions, je tenais avant tout à réfuter les prétendues limites de la connaissance. Je refusais de suivre le chemin de connaissance s'adressant au monde sensible et qui, à partir de celui-ci, de l'extérieur, tente de percer jusqu'à la vraie réalité. Je voulais montrer que ce n'est pas en se frayant un passage vers l'extérieur que l'on trouve la vraie réalité, mais par une démarche conduisant vers la vie intérieure de l'homme. Celui qui s'efforce de percer vers le dehors pour constater l'impossibilité d'un tel cheminement, invoque alors des « limites de la connaissance ». Or, cette impossibilité n'est pas due à la limitation, chez l'homme, de la faculté de connaître; elle s'explique par le fait que la recherche porte sur une chose dont toute introspection sérieuse prouve l'inexistence. En poussant plus avant dans le monde des sens, on cherche en quelque sorte un prolongement du sensible au-delà du monde perçu. C'est comme si, vivant dans des illusions, nous voulions aller chercher dans de nouvelles illusions les causes des premières.
Le sujet de mon raisonnement était alors le suivant: dès sa naissance et tout au long de son existence l'être humain développe son besoin de connaître le monde. Il parvient d'abord à la contemplation du sensible. Mais ce n'est là qu'une démarche préliminaire à la connaissance. La perception ne permet pas de dévoiler tout ce que contient le monde. L'essence du monde est cachée; dans un premier temps, l'homme n'accède pas jusqu'à cette essence. Il demeure d'abord fermé à une telle réalité. N'opposant pas encore au monde son être propre, il élabore une image du monde à laquelle manque cette essence. A ce stade, l'idée que l'on se fait du monde est, à vrai dire, pure illusion. Tant que l'homme s'en tiendra à la seule perception sensible, il se trouvera toujours face à un monde illusoire. Par contre, si au fond de son être la pensée libérée du sensible vient se joindre à cette perception sensorielle, l'illusion s'imprègne de réalité; elle cesse d'être une simple illusion. L'esprit humain, prenant conscience de soi, rencontre alors l'esprit du monde, qui ne se dissimule plus derrière le sensible, mais apparaît comme agissant au sein même de celui-ci.
Découvrir ainsi l'esprit à l'intérieur du monde sensible ne me semblait devoir relever ni de conclusions logiques ni d'un quelconque prolongement de la perception sensorielle; je considérais que l'homme peut y parvenir lorsqu'il progresse et s'élève de la perception sensorielle à l'expérience de la pensée libérée du sensible.
J'étais pénétré de pensées de ce genre lorsque, en 1888, j'écrivis dans le second tome de mon édition des œuvres scientifiques de Goethe: « Celui qui reconnaît à la pensée une faculté de perception dépassant le domaine de la perception sensorielle, doit nécessairement lui attribuer des objets situés au-delà de la réalité sensible. Ces objets de la pensée, ce sont les idées. En s'emparant de l'idée, la pensée s'unit au principe originel de l'être de l'univers; ce qui agit au dehors pénètre dans l'esprit de l'homme: il s'identifie avec la réalité objective, devient un avec elle. La contemplation de l'idée au sein du réel constitue la vraie communion de l'homme. La pensée a la même importance à l'égard des idées que l'œil à l'égard de la lumière, ou l'oreille à l'égard des sons. C'est un organe de perception ».
Il m'importait peu, à cette époque, de décrire le monde de l'esprit tel qu'il apparaît lorsque, ayant pris conscience de soi, la pensée dégagée du sensible s'élève jusqu'à la contemplation en esprit; je voulais démontrer que la nature perçue par nos sens est d'essence spirituelle, et exprimer qu'en réalité la nature est esprit.
Le destin m'avait conduit à me confronter avec les théories de la connaissance en cours. Les philosophes supposaient au départ une nature dépourvue d'esprit, et se donnaient pour tâche d'examiner dans quelle mesure l'homme a le droit d'élaborer en lui-même une image spirituelle de la nature. Je leur opposais une toute autre théorie de la connaissance. Je voulais montrer que l'homme, en pensant, n'est pas un spectateur qui se forme, du dehors, des images de la nature, mais qu'il se trouve en pensée dans les choses mêmes, participant ainsi à leur essence grâce à l'expérience réalisée par l'acte de connaissance.
C'est encore mon destin qui m'a amené à élaborer mes propres conceptions à la suite de celles de Goethe; lui aussi avait aspiré à une conception spirituelle du monde. A maintes occasions il met en évidence le caractère spirituel de la nature ; mais on ne saurait parler du monde pur de l'esprit, car Goethe n'a pas poussé sa conception spirituelle de la nature jusqu'à la vision directe de l'esprit.
Je tenais ensuite à expliquer mon idée concernant la liberté. Tant que l'homme agit sous la poussée de ses instincts, désirs et passions, etc... il n'est pas libre. Dans ce cas ses actes sont déterminés par des pulsions devenues aussi inconscientes que les impressions du monde sensible. Ce n'est cependant pas encore sa véritable nature qui agit. Son humanité profonde ne se dévoile pas à ce niveau, pas plus que l'essence de la nature ne se révèle à l'observation purement sensible. Le monde sensible n'est pas vraiment une illusion, mais le devient par le fait de l'homme. Par contre, l'homme est en mesure de transformer ses désirs et pulsions en de véritables illusions. C'est alors un élément illusoire qui agit en lui; ce n'est pas lui-même qui est actif: l'action ne découle pas de l'esprit. Ce qui en lui est spirituel n'agit réellement que si les mobiles d'action sont puisés dans le domaine de la pensée libre et affranchie du sensible, sous forme d'intuitions morales. A ce niveau, c'est lui qui agit et non quelque chose d'autre. Il est alors un être libre, un être qui agit de sa propre initiative.
Je voulais montrer qu'en refusant d'admettre la pensée dégagée des sens comme étant un élément purement spirituel dans l'homme, on ne pourra jamais comprendre ce qu'est la liberté; or cette compréhension se fait dès l'instant où l'on a saisi la réalité de cette pensée affranchie du sensible.
Il s'agissait moins pour moi de décrire le monde spirituel dans lequel nous faisons l'expérience de nos intuitions morales, mais bien plutôt d'avoir à souligner le caractère spirituel de ces intuitions. Si j'avais tenu au premier point, il m'eût fallu, dans ma « Philosophie de la Liberté », commencer le chapitre de « L'imagination morale » par ces mots: « L'esprit libre agit selon ses impulsions, c'est-à-dire selon ses intuitions vécues par lui dans le pur monde de l'esprit, en dehors du règne de la nature et sans qu'à l'état d'éveil normal il ait conscience de ce monde de l'esprit ». Cependant je tenais bien à caractériser l'aspect purement spirituel des intuitions morales. C'est pourquoi j'attirai l'attention sur l'existence de ces intuitions parmi l'ensemble des idées humaines, ce que je formulai par ces mots: « L'esprit libre agit selon ses impulsions propres, c'est-à-dire selon des intuitions que la pensée choisit parmi l'ensemble de ces idées ». Celui qui ne se tourne pas vers un monde purement spirituel, et donc ne pourra justifier cette première phrase, ne pourra pas davantage admettre pleinement la seconde. Or, la Philosophie de la Liberté contient un bon nombre de passages se référant à la première thèse, par exemple: « Le stade le plus élevé de la vie individuelle est celui de la pensée conceptuelle sans rapport avec un quelconque contenu perceptif. Nous déterminons le contenu d'un concept par une intuition pure, nous le tirons de la sphère idéelle. Un tel concept n'a de rapport avec aucune perception donnée ». Il s'agit ici de « perception sensible ». Si j'avais voulu parler, à cette époque, du monde de l'esprit, et non pas seulement du caractère spirituel des intuitions morales, j'aurais dû tenir compte du contraste qui existe entre une perception sensible et une perception spirituelle. Mais il m'importait alors seulement de souligner le caractère non-sensible des intuitions morales.
Telle était la direction de mes pensées au moment où se terminait la première époque de mon existence. J'avais alors trente ans, et j'étais sur le point de m'installer à Weimar.